FMCHGE : Association Française de Formation Médicale Continue en Hépato-Gastro-Entérologie
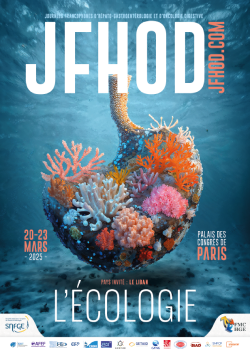
Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie
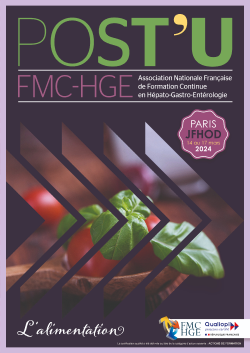
Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie

Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie

Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie
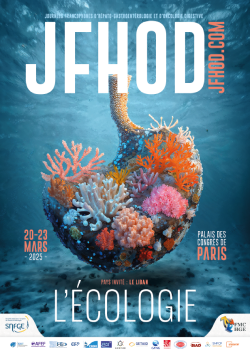
Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie
et d'Oncologie Digestive
Du 20 au 23 mars 2025
L'écologie
Programme de la FMC HGE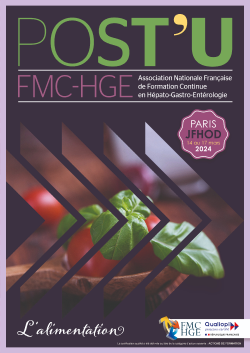
Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie
et d'Oncologie Digestive
Du 14 au 17 mars 2024
L'alimentationn
Programme de la FMC HGE
Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie
et d'Oncologie Digestive
Du 16 au 19 mars 2023 à Paris
L'activité physique
Programme de la FMC HGE
Journées
Francophones
d'Hépato-gastroentérologie
et d'Oncologie Digestive
Du 17 au 20 mars 2022 à Paris
HGE 2.0
Programme de la FMC HGE